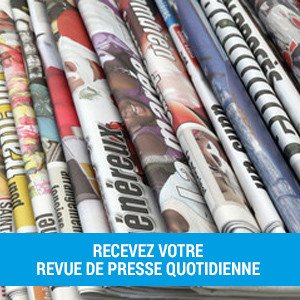Les actualités Histoire avec le Bulletin d'Espalion | Page 2
Retrouvez les actualités Histoire avec le Bulletin d'Espalion | Page 2
![Le Rouergue gallo-romain. Les céramiques sigillées de La Graufesenque [3/3]](https://medias.bulletindespalion.fr/photos/586/54070/)
Le Rouergue gallo-romain. Les céramiques sigillées de La Graufesenque [3/3]
Dans ce dernier épisode consacré aux céramiques sigillées de la Graufesenque, nous allons évoquer une conséquence due à la production massive desdites céramiques, la déforestation des causses environnants, ainsi que l’exportation de nos poteries rouergates et des artisans potiers de la Graufesenque.
![Le Rouergue gallo-romain. Les céramiques sigillées de La Graufesenque [2/3]](https://medias.bulletindespalion.fr/photos/586/53865/)
Le Rouergue gallo-romain. Les céramiques sigillées de La Graufesenque [2/3]
Dans le précédent épisode, nous avons vu que les fouilles entreprises à la Graufesenque permirent de mettre au jour de nombreuses poteries et autres moules. Mais les archéologues dégagèrent également des vestiges de maisons, de sanctuaires et, bien évidemment, de fours. Toutes ces découvertes, sans oublier celles d’assiettes sur lesquelles avait été gravé par les potiers eux-mêmes le détail de leurs tâches, facilitèrent assurément le travail des spécialistes lorsqu’il s’est agi de percer les secrets de la vaisselle sigillée.
![Le Rouergue gallo-romain. Les céramiques sigillées de La Graufesenque [1/3]](https://medias.bulletindespalion.fr/photos/586/53621/)
Le Rouergue gallo-romain. Les céramiques sigillées de La Graufesenque [1/3]
Le musée de la ville de Millau, connu sous le nom de “Musée de Millau et des Grands Causses”, possède une impressionnante collection de céramiques sigillées datant des Ier et IIe siècles de notre ère, lesdites céramiques présentant cette particularité d’être de couleur “rouge vernissée” et, bien entendu, de porter la marque, l’estampille ou le sceau (sigillum en latin) de leur fabriquant. Or, ces nombreux artéfacts proviennent d’un site archéologique situé à seulement deux kilomètres au sud de Millau : le site de la Graufesenque.

Histoire. Bernard Combes de Patris, un grand historien rouergat
S’il est habituel de rappeler l’existence de ces Aveyronnais célèbres qui, par leur talent, ont su se hisser au sommet de la gloire, à l’instar du poète Charles de Pomairols, de la cantatrice Emma Calvé, de l’entomologiste Jean-Henri Fabre ou encore du général Edouard de Curières de Castelnau, on oublie trop souvent de rendre hommage à ces historiens qui, maniant la plume avec habileté, se sont efforcés de perpétuer la mémoire de nos glorieux compatriotes. C’est assurément le cas de Bernard Combes de Patris, historien, essayiste et critique, qui, malgré un exil parisien de plus de trente années, n’oublia jamais son Rouergue natal, principale source d’inspiration de ses écrits.

L’enseignement primaire en Aveyron dans le temps jadis
Alors que le niveau scolaire ne cesse de dégringoler en France, faisons un retour dans le passé pour rappeler cette époque bénie où notre pays occupait la première position mondiale pour la qualité de son enseignement.

Église de Caylus. Notre-Dame de Livron et la légende du monstre tué par le chevalier de Lagardelle
Sur la commune de Caylus (Tarn-et-Garonne) se trouve le vallon de Livron qui, outre son aspect féerique (avec sa grotte, ses rochers et ses frondaisons épaisses), a vu l'édification d'au moins deux édifices religieux et l'instauration d'un pèlerinage basé essentiellement sur une légende et l'apparition d'une source (sous la pioche des terrassiers) aux effets salutaires.

À Bozouls. L’église Sainte-Fauste
Dédiée à sainte Fauste, une chrétienne morte en martyre à Cyzique (en Asie Mineure) au début du IV siècle, l’église romane de Bozouls a été édifiée sur un éperon rocheux dominant un cirque naturel en forme de fer à cheval au fond duquel coule le Dourdou. Cette église, comme la plupart des édifices religieux très anciens, a subi d’importantes transformations au fil des siècles, ayant toutefois conservé son aspect roman (principalement visible à l’intérieur). Plusieurs éléments de ce monument retiendront tout particulièrement notre attention, comme ces chapiteaux historiés ou ce mystérieux “quatre de chiffre”.

Charles de Louvrié. Un inventeur de génie
Pour la célébration du 130 anniversaire de la mort de Charles de Louvrié, l’Association des Amis de C. de L., dont le siège est situé à la mairie de Campouriez (05.65.44.85.31), organise deux journées exceptionnelles, les vendredi 19 et samedi 20 juillet, avec expositions, théâtre, initiation au pilotage de drones, etc. Naturellement, nous encourageons nos lecteurs à venir assister à cet événement qui est, pour nous, l’occasion de rappeler ici le parcours de Charles de Louvrié, personnage à qui nous devons l’invention, au XIX siècle, du premier moteur à réaction…

Estaing. La chapelle de l'Ouradou et son trésor statuaire
À seulement un kilomètre au nord d’Estaing, surplombant légèrement la route conduisant au Nayrac, se présente à notre vue un petit hameau au centre duquel a pris place une chapelle datant du premier quart du XVI siècle.

L’église de Bez-Bédène. Un joyau dans son écrin
Outre sa situation dans un site exceptionnel, l’église Saint-Gausbert de Bez-Bédène présente des particularités qui relèvent aussi bien du roman que du gothique. Suivons notre guide, Pascal Cazottes, à sa découverte.

Patrimoine religieux. Notre-Dame la Négrette, la protectrice d’Espalion
À Espalion, l’hôpital Jean Solinhac abrite dans sa chapelle une statue de la Vierge Marie connue sous le nom de Notre-Dame la Négrette. Considérée comme une Vierge Noire, nous verrons que cette statue est, en réalité, tout autre chose.

Histoire & patrimoine. L’église de Caylus et son portail énigmatique
A Caylus, petit bourg du Tarn-et-Garonne dont le nom dérive du bas latin castellucium faisant référence à un château, l’église du lieu offre à la vue du visiteur un étonnant portail peuplé de créatures énigmatiques — comme ces dragons que nous ne manquerons pas d’évoquer — ou d’animaux bien plus réels mais à la symbolique tout aussi surprenante…
![Histoire. À la recherche de Carantomagus [2 et fin]](https://medias.bulletindespalion.fr/photos/586/50190/)
Histoire. À la recherche de Carantomagus [2 et fin]
Dans ce deuxième et dernier épisode consacré à Carantomagus, nous allons évoquer tous les différents éléments qui, en plus du nom précédemment analysé, nous amènent à penser que Cranton fut bel et bien l’ancienne Carantomagus.
![Histoire. À la recherche de Carantomagus [1]](https://medias.bulletindespalion.fr/photos/586/49957/)
Histoire. À la recherche de Carantomagus [1]
Carantomagus était une ancienne cité gallo-romaine dont l’existence passée fut découverte grâce à la Table de Peutinger. Au XIX siècle, on tenta de localiser l’emplacement de Carantomag. C’est alors que plusieurs éléments — comme le résultat des fouilles archéologiques menées par l’abbé Cabaniols — vinrent désigner le hameau de Cranton, sis commune de Compolibat (département de l’Aveyron), comme étant le lieu de l’antique Carantomagus. D’ailleurs, c’est aussi à cette conclusion qu’aboutirent les recherches menées par Eugène Marre, professeur départemental d’agriculture de 1892 à 1918, directeur des services agricoles de l’Aveyron et membre de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron. Ce dernier rassembla le résultat de ses travaux dans un livre intitulé «CARANTOMAG, CARANTOMAGUS (CRANTON)», ouvrage qui, sorti des presses de l’imprimerie Carrère en 1916, fait toujours autorité en la matière, nous fournissant nombre d’informations que nous ne manquerons pas de rappeler dans les présentes colonnes.
-
11h28Rugby. La réserve du RCENA finalement qualifiée !
-
06h32Climat. Station Météo Nord Aveyron
-
06h32Étoile Michelin. Un nouvel aveyronnais étoilé
-
06h31Les “gros mots” de Jean-Paul Pelras. Les prudents
-
06h31Aveyron. Le département vote de nouvelles motions
-
06h31Dans la valise de nos abonnés. Le Bulletin d'Espalion à la Havane
-
06h31Bravo au jardinier. Une belle carotte de… 854 grammes !
-
06h31Mémoire du XXe siècle. Un appel à contribution pour le projet “Espalion, cité des Peintres”
-
06h31Festival des Bœufs Gras de Pâques. Laguiole célèbre la 26 édition du Festival des Bœufs Gras avec succès
-
06h30Assemblée générale annuelle de la Fédération des Chasseurs de l’Aveyron
-
06h30Assemblée générale Fédération des Foyers ruraux de l'Aveyron
-
06h30Théâtre. “Vacarme(s)”, un hymne au monde rural, à Lioujas et Campuac
-
06h30Santé. Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants du Valadou
-
06h30Culture Sud-Ouest. Les Souvenirs de Nestor
-
06h30Distinction. Le maire de la cité reçoit la Marianne d’Or du patrimoine
-
06h30Marché aux bestiaux. Le nouveau fonctionnement repoussé à la fin de l'année
-
06h30Conservatoire départemental de musique. L'accordéon en vedette au complexe Cardabelle
-
27/03Blues Rock. Une nouvelle édition de Lax'n Blues à Baraqueville samedi 29 mars
-
27/03Les brèves de la semaine.
-
27/03Le “gros mot” de Jean-Paul Pelras. L’ours !
-
1 -Laguiole. Festival des Bœufs Gras ces 29 et 30 mars
-
2 -Boutique éphémère. Le baptême ruthénois des jeans Tuffery à la Chapelle
-
3 -Passage à l'heure d'été. L'histoire du changement d'heure
-
4 -Aveyron. Claire Chauffour-Rouillard fait le point sur ses premier mois à la préfecture
-
5 -Sauvegarde de la Saint-Fleuret. À la recherche de photos de la Saint-Fleuret